« Une étape décisive vers la paix et la stabilité »
- Par Sainclair MEZING
- 03 Jul 2025 10:46
- 0 Likes

Dr Simon Pierre Omgba Mbida, ministre plénipotentiaire et internationaliste.
Un accord de paix vient d’être signé par la RDC et le Rwanda. Pensez-vous qu’il puisse contribuer à mettre fin au conflit actuel et à ramener une paix durable à l’Est de la RDC ?
Cet accord de paix est présenté comme une avancée majeure dans les efforts pour mettre fin à plus de 30 ans de guerre à l’Est du pays, est diversement apprécié au sein de la classe politique congolaise, mais il a été salué par plusieurs chefs d’État africains et occidentaux. Cependant, il suscite des critiques acerbes de la société civile et d’intellectuels, qui y voient une forme de capitulation géopolitique et de compromission sur des questions fondamentales de souveraineté et de justice. En réalité, si cet accord de Washington revêt bien un caractère historique, les choses sont loin d’être réglées, sur le terrain notamment, car le conflit se poursuit encore à l’Est de la RDC. Puisque la mise en œuvre de l'accord nécessite le retrait effectif des troupes, le désarmement des groupes rebelles et l'inclusion des populations locales dans le processus. C’est la prise en compte effective de tous ces éléments qui décideront du succès ou de l'échec de cette initiative diplomatique portée par les Etats Unis. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est l'engagement des États-Unis. Donald Trump veut marquer l’histoire parce qu’il vise le prix Nobel de la paix. Mais cela ne garantit pas forcément l'application sur le terrain. La coalition gouvernementale congolaise demande l’application stricte de l’accord en droite ligne de la résolution 2773 de l’ONU adoptée en février dernier qui condamne le Rwanda pour son soutien à l’offensive des rebelles du M23 dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu et lui demande de quitter le territoire de la RDC. A l’observation, la logique actuelle du projet repose sur l'idée qui serait peut-être une erreur fondamentale que la paix pourrait être obtenue par le partage ou l'exploitation conjointe des ressources naturelles, notamment les minéraux critiques du Kivu. On ne fait pas la paix à cause des ressources naturelles sachant que les causes profondes du conflit sont ailleurs. Elles relèvent de la citoyenneté, des droits, de l'identité, de l'hégémonie régionale et même de revendications territoriales injustifiées.
Sur le papier, la pacification de l’Est de la RDC semble évidente. Comment sur le terrain une telle initiative peut-elle être possible au regard de la réalité ?
L’accord repose sur deux piliers : la sécurité et l’économie. Ce sont les deux priorités sur le terrain qui prévoient le désengagement progressif des troupes rwandaises, la neutralisation des groupes armés et le retrait des mesures défensives mises en place par le Rwanda ainsi que le retour des déplacés sous l’autorité du gouvernement congolais. Ces actions doivent être réalisées en quatre mois, en plusieurs étapes. Sur le plan économique, l’accord ouvre la voie à une coopération bilatérale dans les domaines de l’énergie, de la traçabilité des minerais et de l’intégration régionale. Ainsi, selon les termes de l’accord, d’ici au 27 septembre prochain, un cadre d’intégration économique régionale doit être lancé. L'objectif est de renforcer la coopération sur les ressources naturelles, le commerce et les investissements transfrontaliers. Sur ce point, certains experts sur les questions politiques, économiques et sécuritaires dénoncent une dynamique de « néocolonialisme économique », estimant que les États-Unis obtiennent un accès stratégique aux ressources congolaises, tandis que le Rwanda maintient son influence sur les chaînes d’approvisionnement minières. D’autres, plus positifs ou généreux, estiment à contrario que ce nouveau cadre favorisera une prospérité partagée entre les pays de la région, sans compromis sur la souveraineté ni l’intégrité territoriale de la RDC. Cet accord, bien que perfectible, peut donc représenter une réelle opportunité pour faire taire les armes.
Avec la mise à l’écart des groupes armés des pourparlers, d’aucuns redoutent déjà un échec comme avec les précédents accords. En quoi est-ce que celui-ci est-il différent ?
Effectivement, ce n’est pas la première fois que Washington s’implique dans la crise de l’Est du Congo. Le 26 octobre 2004, un accord tripartite entre la RDC, le Rwanda et l’Ouganda était signé à Kigali, sous la facilitation américaine. L’objectif était d'instaurer des mécanismes conjoints de s&...
Cet article complet est réservé aux abonnés
Déjà abonné ? Identifiez-vous >
Accédez en illimité à Cameroon Tribune Digital à partir de 26250 FCFA
Je M'abonne1 minute suffit pour vous abonner à Cameroon Tribune Digital !
- Votre numéro spécial cameroon-tribune en version numérique
- Des encarts
- Des appels d'offres exclusives
- D'avant-première (accès 24h avant la publication)
- Des éditions consultables sur tous supports (smartphone, tablettes, PC)

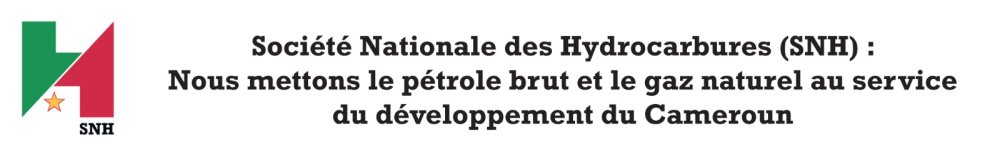






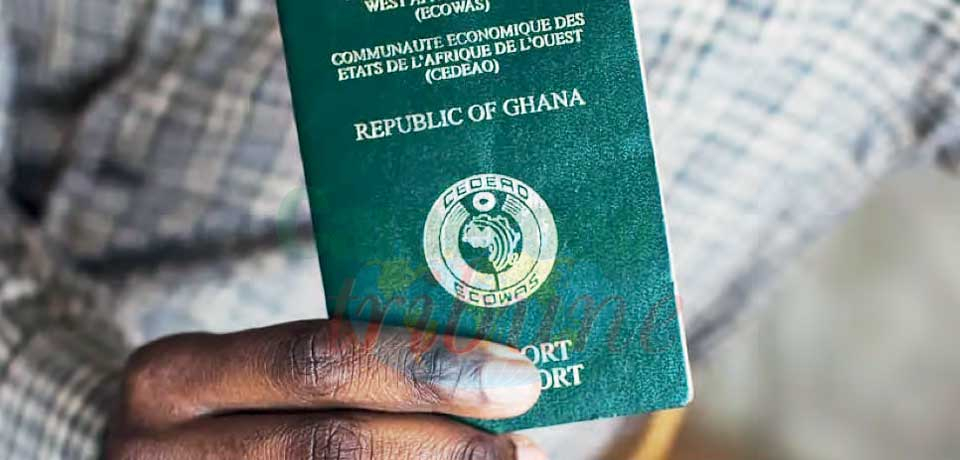

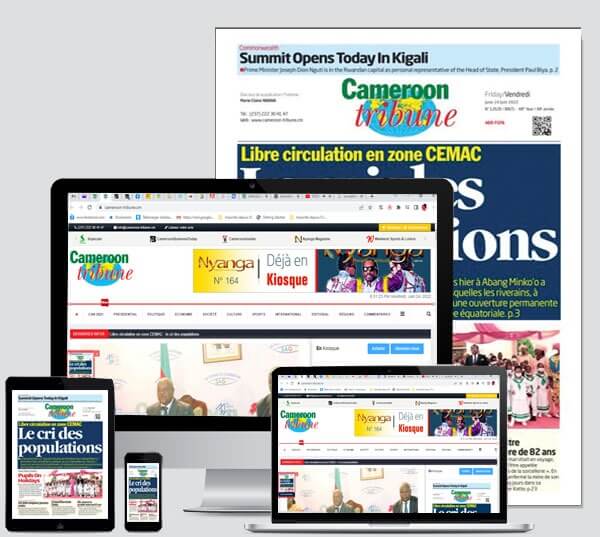


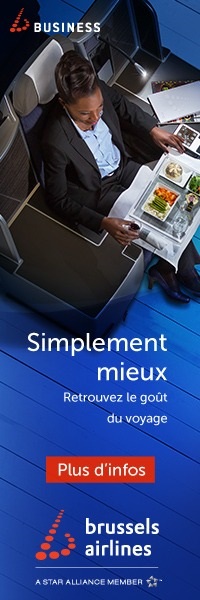
Commentaires