« Le Cameroun s’inscrit dans le principe de non-ingérence »
- Par Sainclair MEZING
- 05 Nov 2025 12:16
- 0 Likes

Dr. Serge Christian Alima Zoa, internationaliste, Centre de recherche et d’études politiques et stratégiques (CREPS) de l’Université de Yaoundé II-Soa, Université catholique d’Afrique centrale.
Dans une déclaration à la presse dimanche dernier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, appelle les chancelleries des pays amis à la prudence dans le cadre leurs prises de position sur le climat sociopolitique actuel au Cameroun. Comment analysez-vous cette sortie ?
Dans un contexte de tensions internes, les États cherchent à affirmer leur autonomie décisionnelle. Soulevant d'importantes questions sur les rapports entre diplomatie, souveraineté et légitimité dans un landerneau africain marqué par une sensibilité accrue aux interférences perçues. La déclaration du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, s’inscrit dans cette dynamique de rappel à certaines chancelleries du principe de non-ingérence, pierre angulaire du droit international. Pour autant, ces diplomaties, en publiant régulièrement des avis sur la situation intérieure camerounaise, usent de leur droit à la diplomatie publique. Le gouvernement y voit cependant une forme de pression extérieure sur des équilibres politiques internes, d’où sa réaction ferme. Ce positionnement peut aussi s’interpréter comme une stratégie de maîtrise de l’image internationale dans un contexte de polarisation de l’opinion nationale. Il met donc en exergue la frontière mouvante entre dialogue diplomatique, souveraineté et légitimité démocratique des prises de position étrangères, dans une Afrique désormais plus attentive à la défense de ses choix souverains.
En matière d’ingérence, que préconise la Convention de Vienne dans les rapports entre les Etats ?
D’emblée, il convient d’entrevoir la notion d’ingérence dans le cas d’espèce comme une immixtion d’un État dans les affaires intérieures d’un autre État. Elle présente un caractère malveillant, toxique, voire délictueux, car elle vise à déstabiliser, à saper la confiance dans les institutions d’un pays, à engendrer de la confusion entre le vrai et le faux, à servir les intérêts d’une puissance étrangère, pouvant même aller jusqu’à tenter de détruire une cible, par exemple le système démocratique d’un État. C’est pourquoi elle ne doit pas être confondue avec les politiques d’influence. Traité fondamental du droit international qui encadre des interactions diplomatiques entre États souverains, adopté le 18 avril 1961 et officiellement entré en vigueur le 24 avril 1964, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques joue un rôle déterminant dans la facilitation de relations internationales pacifiques, en garantissant aux diplomates la liberté d'assumer leurs fonctions sans que le gouvernement d'accueil n'exerce d'influence sur eux. Elle codifie les pratiques de ces interactions et interdit aux représentants diplomatiques de s'ingérer dans les affaires politiques intérieures d'un État. Son article 41 stipule que les diplomates ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'État accréditaire, et en aucun cas leurs privilèges et immunités ne leur permettent d'intervenir dans les affaires politiques internes. Cela signifie concrètement qu’un diplomate ne peut soutenir publiquement une opposition politique, critiquer les institutions locales, se livrer à des activités perçues comme influençant ou déstabilisant les équilibres politiques internes, abriter dans les locaux de la mission, des réunions à visée poli...
Cet article complet est réservé aux abonnés
Déjà abonné ? Identifiez-vous >
Accédez en illimité à Cameroon Tribune Digital à partir de 26250 FCFA
Je M'abonne1 minute suffit pour vous abonner à Cameroon Tribune Digital !
- Votre numéro spécial cameroon-tribune en version numérique
- Des encarts
- Des appels d'offres exclusives
- D'avant-première (accès 24h avant la publication)
- Des éditions consultables sur tous supports (smartphone, tablettes, PC)

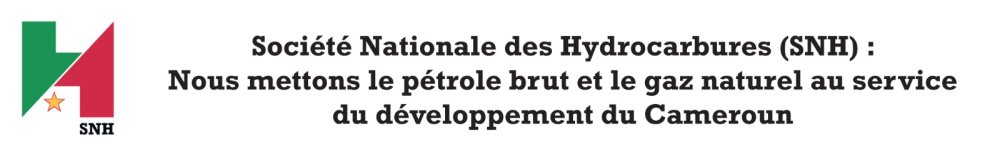








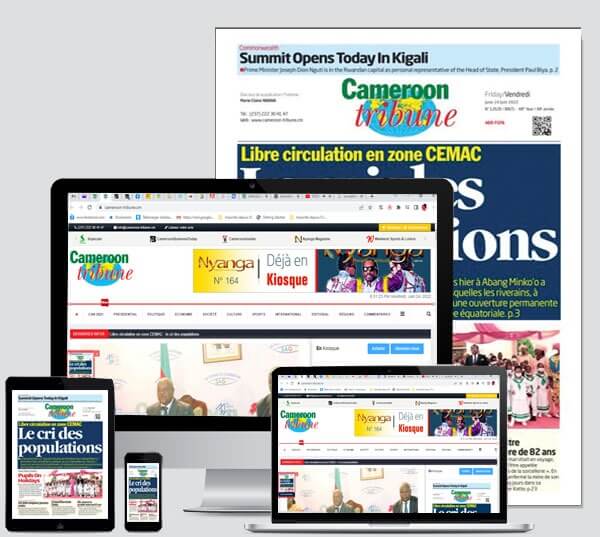


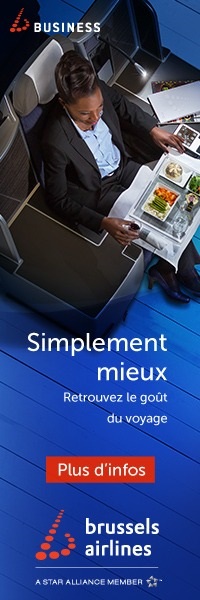
Commentaires