« L’expérience de la compétition électorale a fait la différence »
- Par Lucien BODO
- 29 Oct 2025 12:09
- 0 Likes

Pr. Aristide Menguele, enseignant de science politique, Université de Douala.
Quelle est votre première analyse du résultat de l’élection présidentielle qui a vu Paul Biya réélu ?
À l’analyse, ces résultats sont des informations crédibles sur les mutations en cours dans la géographie et la sociologie électorales. Dans ces résultats, il y a un message portant sur l’évaluation populaire de la gestion du précédent mandat. Aussi, un effort de contextualisation du scrutin électoral qui aboutit à ces résultats indique-t-il que cette élection s’est déroulée dans un contexte sui generis où l’option pour la continuité s’oppose à une volonté, mieux un besoin manifeste de rupture. Quel que soit le prisme sous lequel on analyse, il convient d’indiquer que le stable et le variable dans la sociologie électorale consécutive à cette élection sont des éléments probants de l’évaluation populaire du précédent mandat dans ses points de satisfactions et d’insatisfactions, ses acquis et son passif. Globalement, il apparaît que les Camerounais ont fait le pari de la prudence, du réalisme et de l’espérance.
Selon vous, quel a été l’élément décisif ?
Il faut nécessairement intégrer dans l’analyse une agrégation de facteurs tels que le quadrillage territorial qui fait du RDPC un parti national du point de vue de son assise territoriale, l’expérience de la compétition politique engrangée par le parti depuis le retour du multipartisme, le rapport au marketing politique et aux stratégies de séduction populaire et la part du charisme individuel par rapport aux autres candidats en lice. L’assise nationale du parti qui a investi le candidat Paul Biya est un avantage comparatif majeur. Contrairement aux autres candidats portés par des partis régionaux et/ou départementaux, le président proclamé vainqueur a été investi par un parti qui a patiemment et méthodiquement quadrillé le territoire national et bénéficie de surcroît du soutien d’autres formations politiques notamment dans le cadre du G20. Ensuite, l’expérience de la compétition politique accumulée par le parti politique et son candidat depuis le retour du multipartisme a certainement fait la différence. En effet, depuis l’élection présidentielle anticipée du 11 octobre 1992, le RDPC a régulièrement, et sans discontinuer, présenté le même candidat. Or, les autres formations politiques ont souvent soit boycotté ou simplement choisi de soutenir un autre candidat manquant ainsi des opportunités d’accumuler de l’expérience dans la compétition politique.
On a observé beaucoup d’engouement pour les inscriptions sur les listes électorales. Mais au final, le taux d’abstention est resté élevé. Comment l’expliquer ?
Souvent considéré comme la pire forme de menaces contre les démocraties ou le plus grand parti politique dans les démocraties contemporaines, l’abstentionnisme est un phénomène banal. Il peut se pratiquer « hors-jeu » ou « dans le jeu ». Il peut aussi être apolitique ou non, notamment lorsqu’il est pratiqué pour passer un message. Avec un taux d’abstention de 42,24%, le scrutin présidentiel du 12 octobre 2025 pose le problème des rationalités qui président à cette forme de démobilisation politique. S’il a pu être si élevé à l’occasion de ce scrutin, c’est parce que le taux d’abstention traduit à la fois une démobilisation et une désaffection politiques imputables à l’échec d’une coalition de l’opposition, l’indécision face aux offres politiques proposées, les idées reçues sur l’administration de l’élection, l’inéligibilité de Maurice Kamto et les interférences religieuses de la politique, etc.
Certaines forces politiques ont régressé par rapport aux échéances passées. Bello Bouba Maïgari, Joshua Osih notamment. Qu’est-ce qui l’explique ?
L’une des attentes fortes de cette élection était centrée sur la coalition des partis politiques de l’opposition en vue de la désignation d’un candidat consensuel. Une telle perspective a forcément eu des conséquences sur le capital sympathie des candidats. À ceci s’ajoute la capacité de mobilisation, l’aura et le charisme des candidats qui connaissent cette régression du point de vue de l’affection politique et du capital sympathie. Pour certains, les conflits de générations, la revendication forte du nécessaire rajeunissement de l’élite politique...
Cet article complet est réservé aux abonnés
Déjà abonné ? Identifiez-vous >
Accédez en illimité à Cameroon Tribune Digital à partir de 26250 FCFA
Je M'abonne1 minute suffit pour vous abonner à Cameroon Tribune Digital !
- Votre numéro spécial cameroon-tribune en version numérique
- Des encarts
- Des appels d'offres exclusives
- D'avant-première (accès 24h avant la publication)
- Des éditions consultables sur tous supports (smartphone, tablettes, PC)










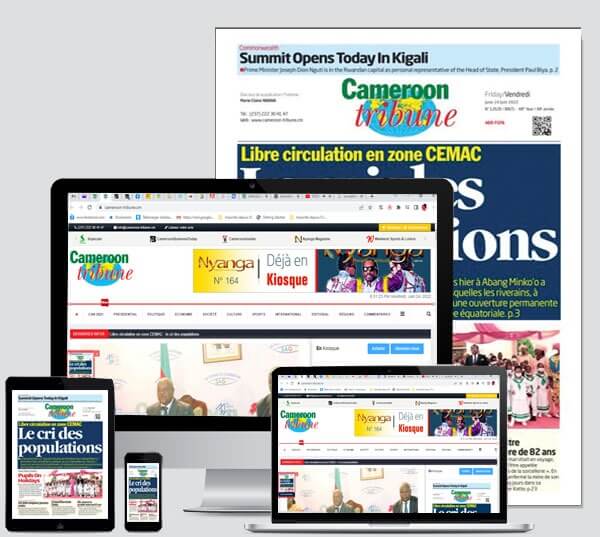


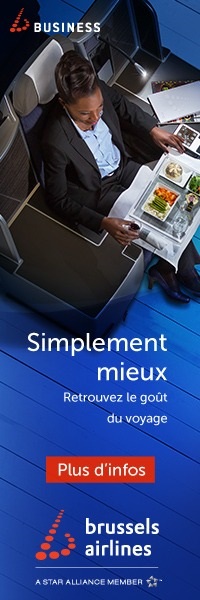
Commentaires